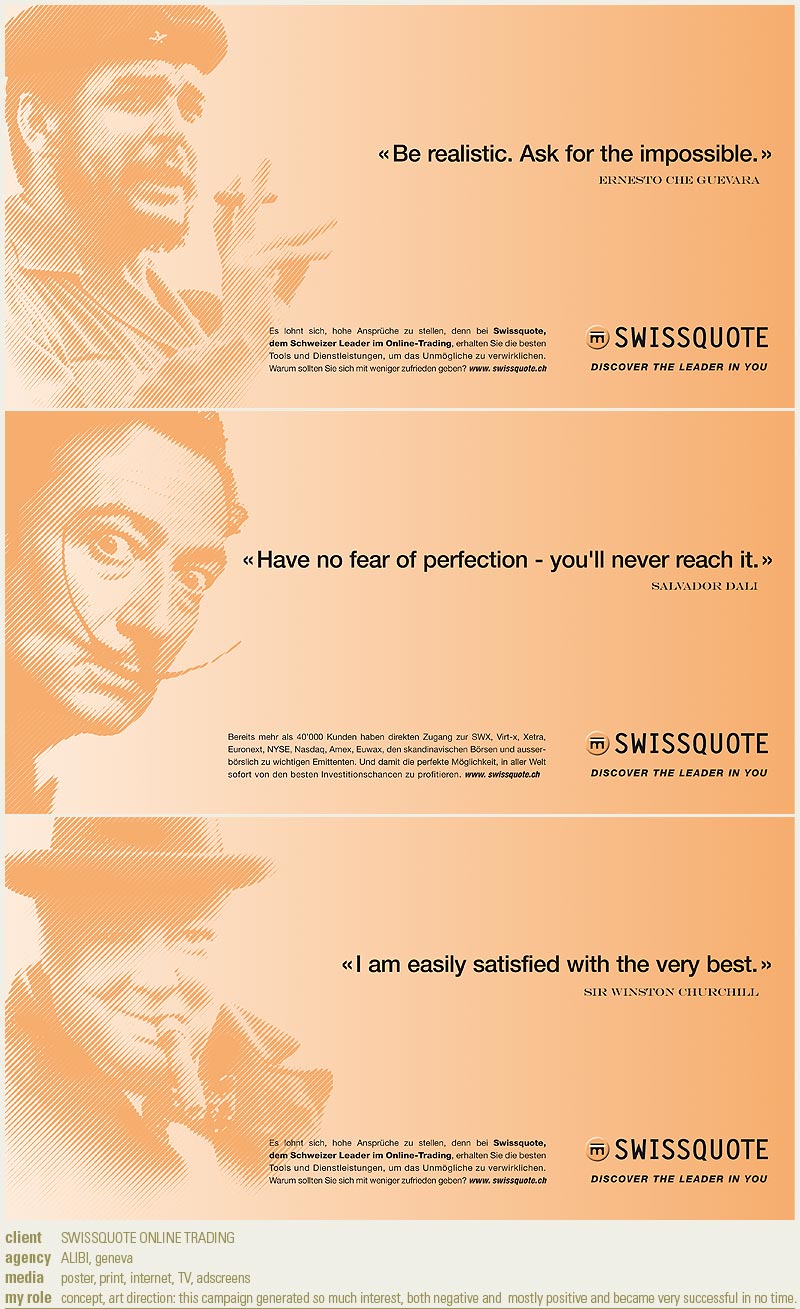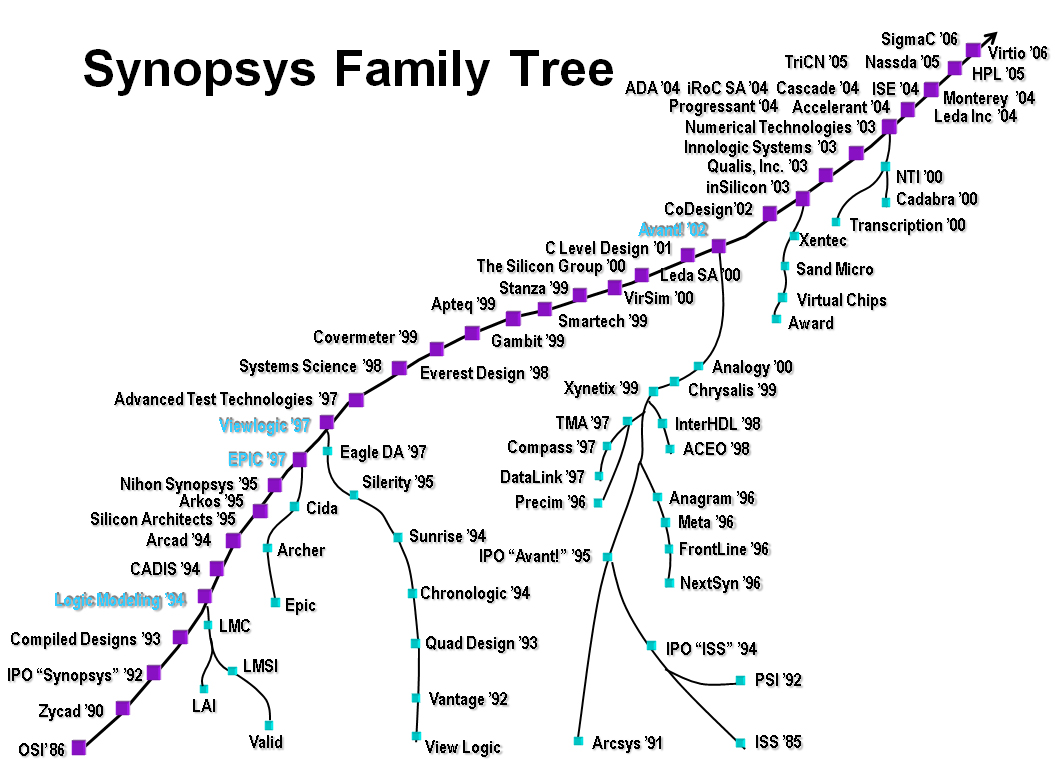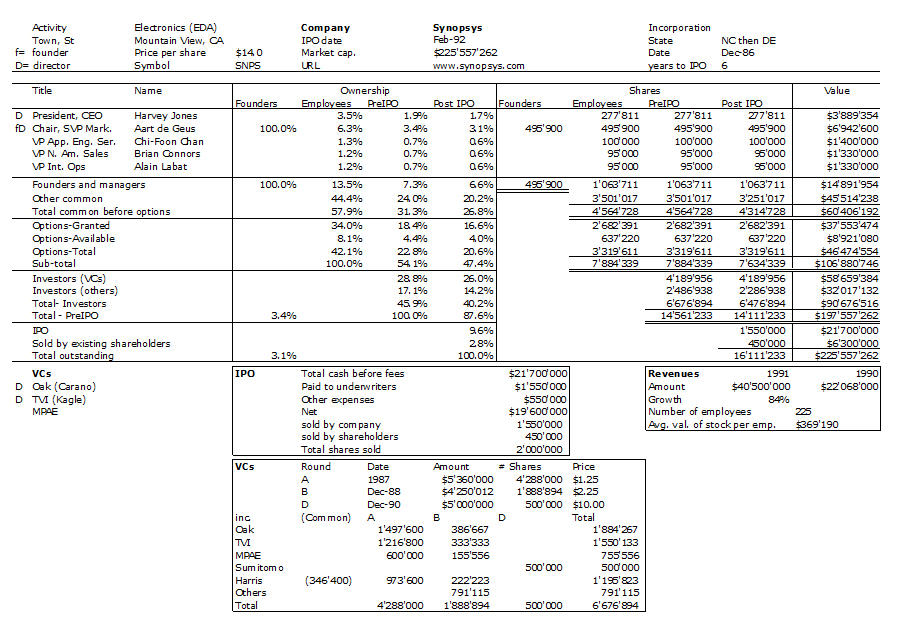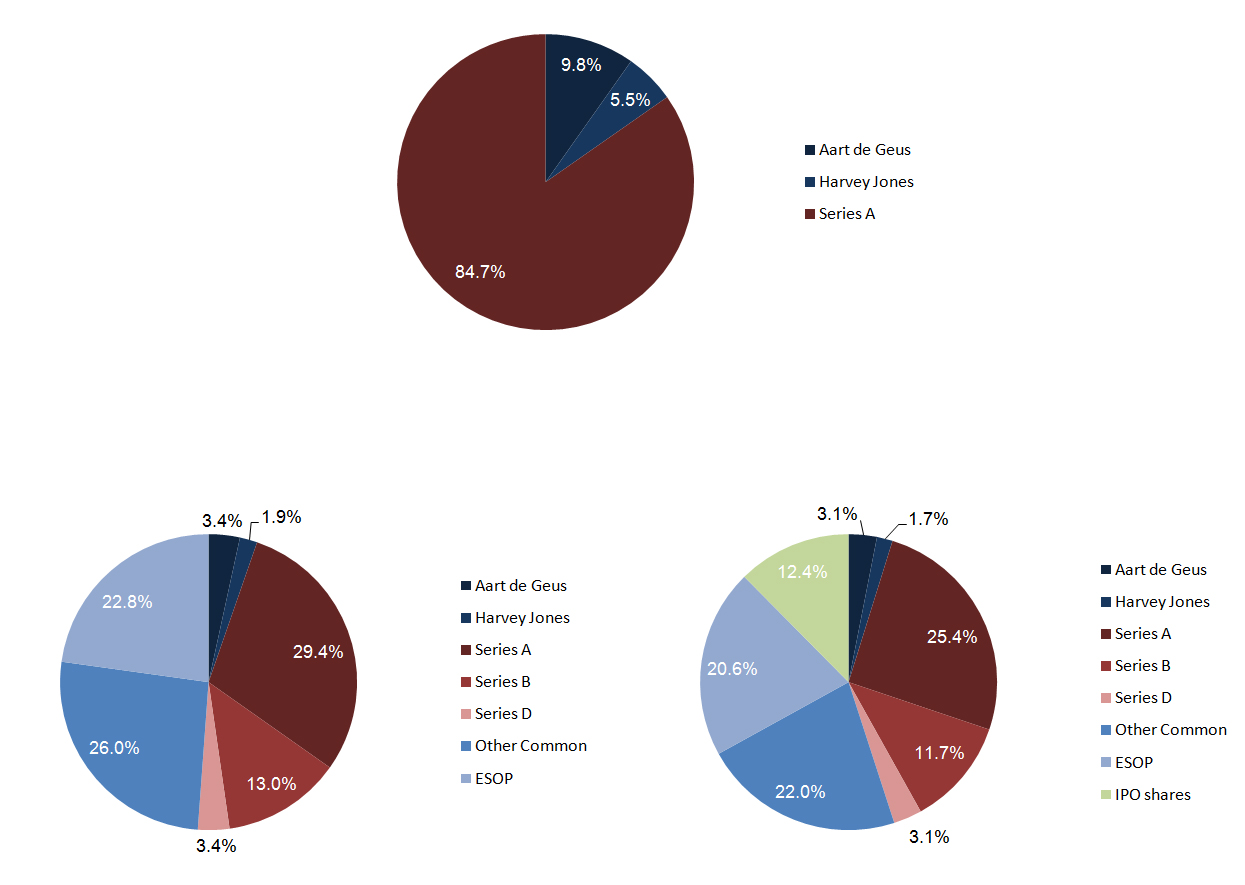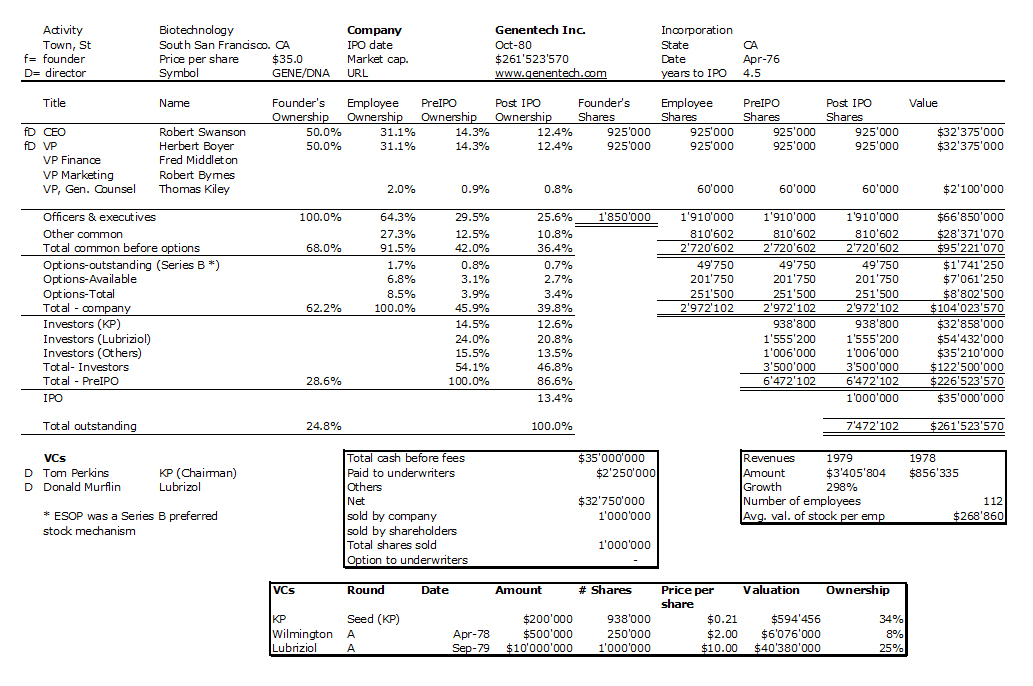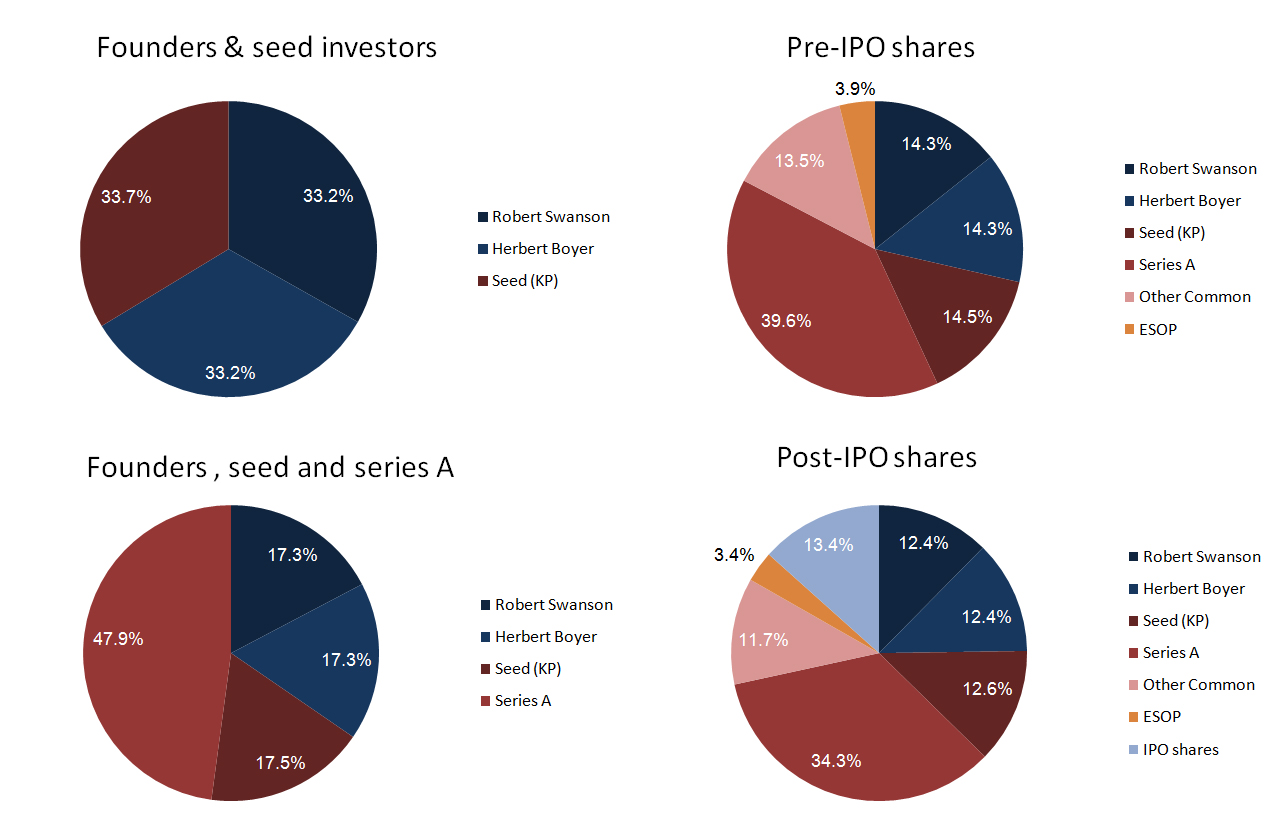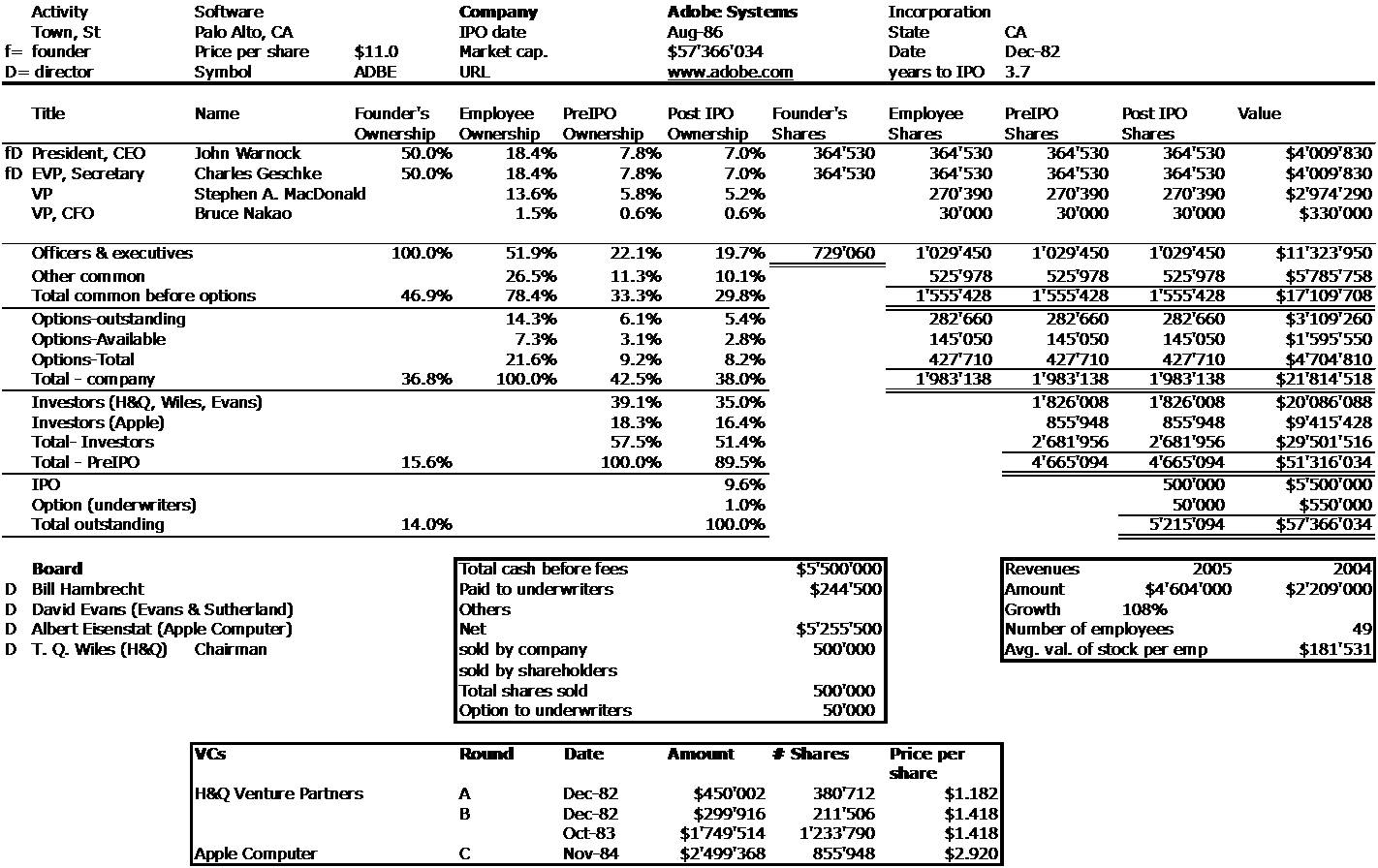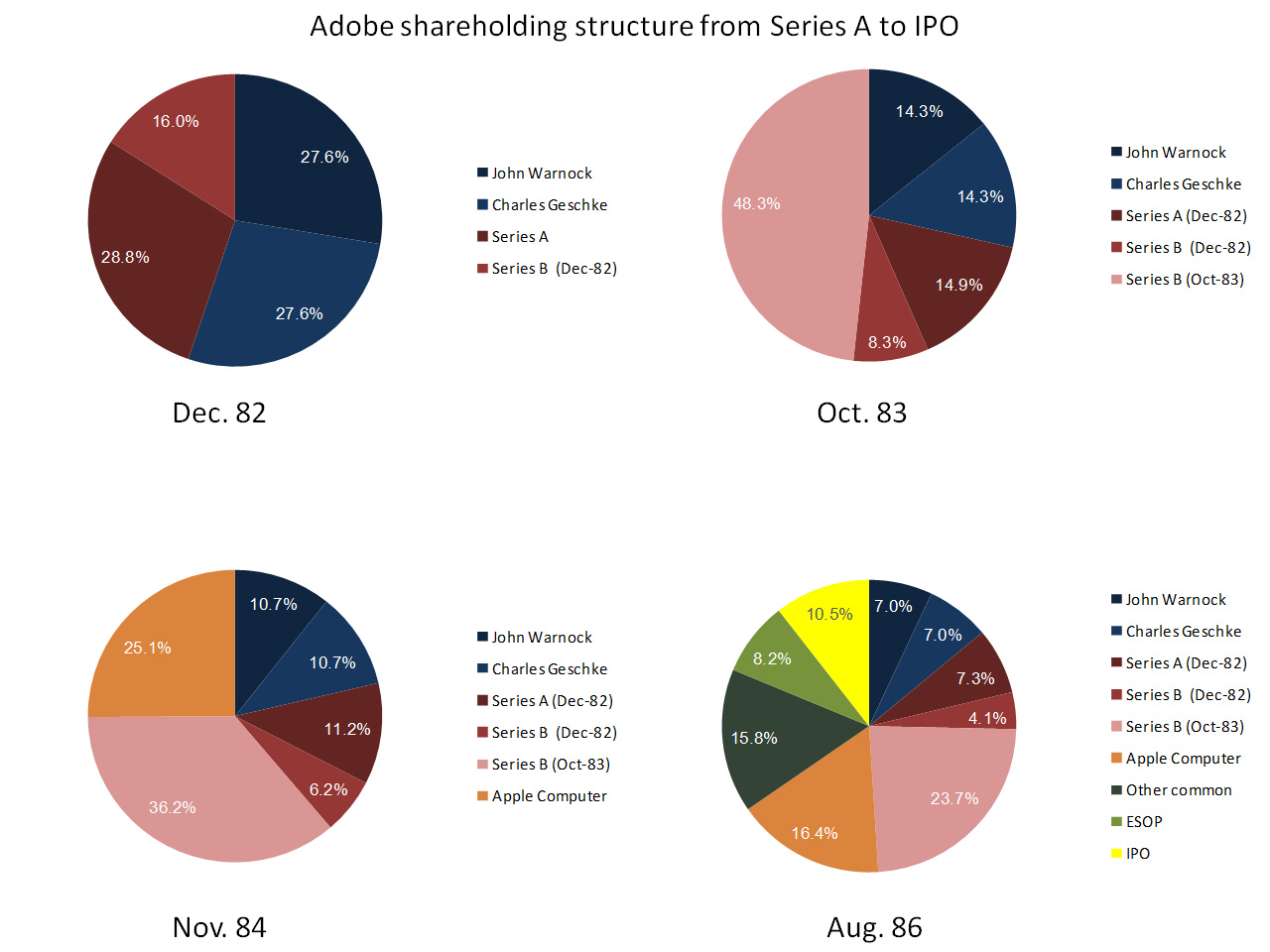Dans cette nouvelle contribution au magazine Créateurs, je reste en Suisse avec deux très jolies PMEs. J’espère que vous apprécierez!
Il est un débat récurrent dans le monde des start-up : et si le modèle américain de la croissance rapide alimentée par du capital-risque agressif n’était pas adapté aux entrepreneurs européens ou suisses. Deux exemples permettent d’apporter des éléments au débat : Sensirion et Mimotec.
Dans ma dernière contribution, j’avais présenté Swissquote qui est devenu un magnifique succès sans ce capital-risque tant décrié semble-t-il en Europe. Mimotec est une spin-off de l’EPFL avec 24 employés et un chiffre d’affaires de 10 millions. La société fournit de la micro-technologie pour l’industrie de la montre. Mimotec a été fondée en 1998 par Hubert Lorenz, qui en a conté l’histoire lors du dernier « venture ideas » de l’EPFL. Cette PME est sans aucun doute une success story qui suit un modèle de croissance organique, soutenue sans être pour autant exponentielle.
Sensirion est peut-être plus impressionnante encore. Fondée en 1998 également, elle est issue de l’ETHZ et fournit des capteurs de pression, autre domaine de spécialité de la Suisse. Dans un article pour la conférence MEMS 2008, son fondateur et CEO, Felix Mayer décrit le modèle de croissance de sa société. J’en traduis un passage : « Les Européens et les Suisses en particulier ne cherchent pas le grand succès. Ils préfèrent commencer petit et mettre un pied devant l’autre […] Autant que je sache, les Américains suivent plutôt la devise suivante : visons la lune ; si nous la loupons, nous finirons dans les étoiles […] Les USA ont une culture du risque et même quand ils échouent, ils ont une deuxième chance. L’Europe est différente. »
Mayer ajoute que parce que les moyens financiers font défaut, l’entrepreneur européen aura du mal à s’attaquer aux très gros marchés. Il croit toutefois à une voie intermédiaire, qui ne générera pas des Google mais des sociétés leader dans leurs niches. Grâce au soutien patient d’un généreux business angel et fort de ses clients, Sensirion compte en 2010, 180 employés (le chiffre d’affaires n’est pas connu puisque la société est aux mains d’actionnaires privés). Il n’en demeure pas moins que Sensirion mettra six ans avant de financer sa croissance par ses activités ; son business angel fut donc essentiel au succès de la PME.
Y a-t-il donc un modèle que l’Europe peut créer sans copier le modèle américain ? Oui, si l’on constate que très peu de sociétés ont atteint la taille d’un Logitech ou d’un Actelion. Au-delà des succès remarquables d’Hubert Lorenz et de Felix Mayer, je ne peux m’empêcher d’émettre les mêmes réserves que dans mon livre Start-Up. Pourquoi l’Europe ne devrait-elle pas viser les très gros succès en plus des succès de taille moyenne ? Ne croyez-vous pas que les Américains ont aussi leur Sensirion et leur Mimotec en plus de leur Google et Apple ? La critique du capital-risque est finalement assez facile, et je préfère à tout choisir cette remarque d’un entrepreneur américain : « La capital-risque, vous ne pouvez pas vivre avec lui, mais vous ne pouvez pas vivre sans lui ! » Et n’oublions pas que Google a aujourd’hui 20 000 employés et fut elle aussi créée en 1998… Il ne fait aucun doute que ni notre culture ni nos modèles financiers ne sont adaptés à fabriquer des Google mais je crois profondément que nous devons aussi avoir l’ambition des grands succès et ne pas sans cesse critiquer un modèle américain qui a aussi bien des atouts.