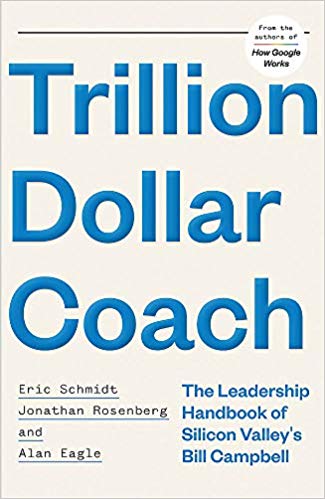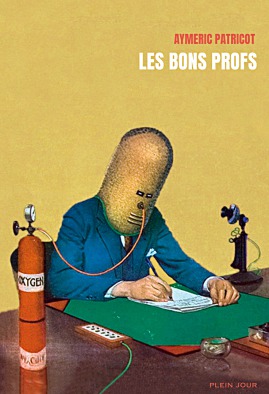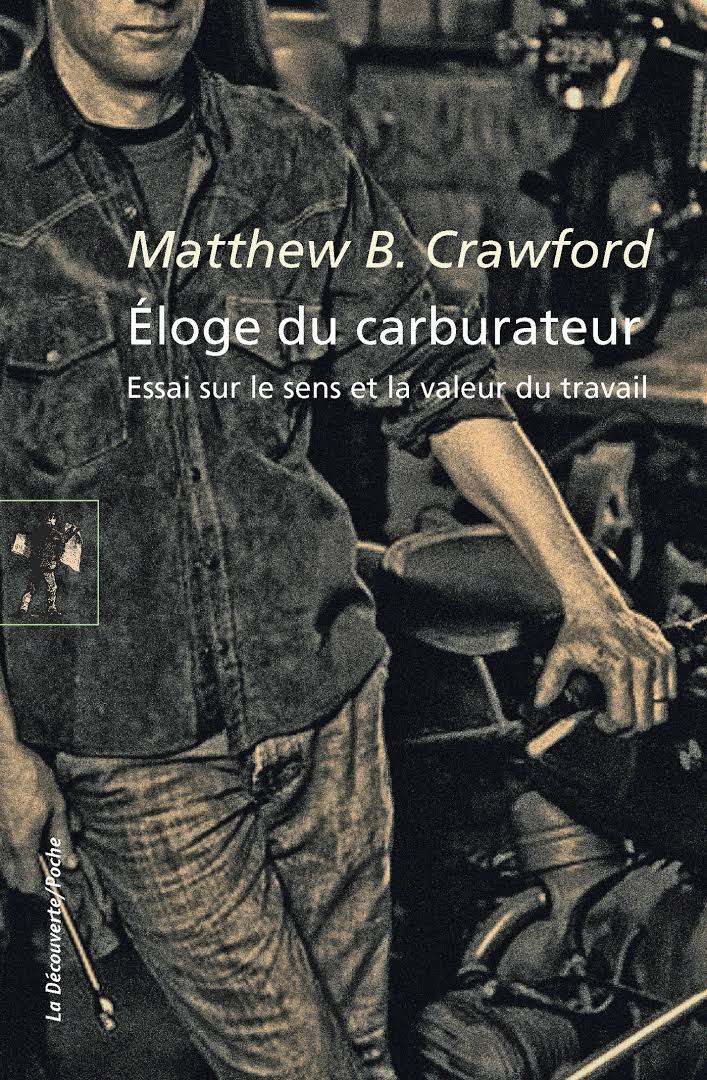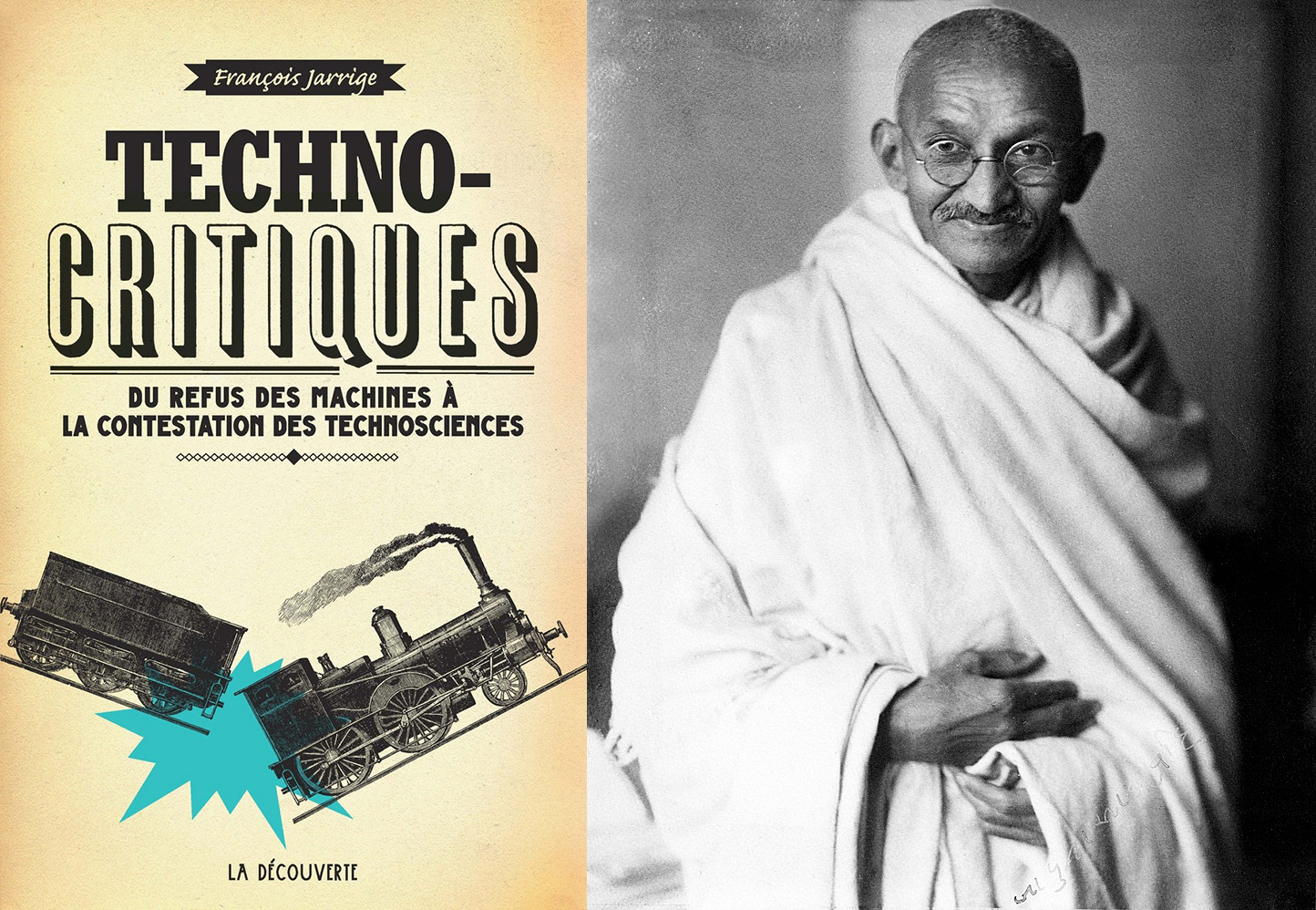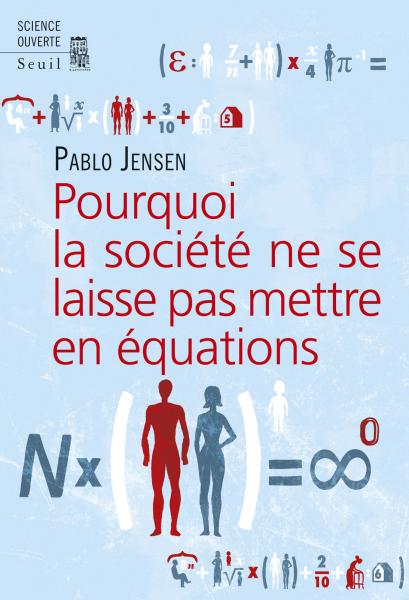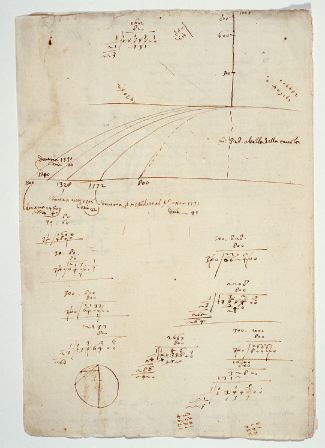Un second et bref article comme suite à celui-ci, ici. Quelques notes.
Eric Schmidt et ses co-auteurs insistent sur l’importance des équipes, des personnes et des produits. Par exemple:
« Dans notre livre précédent, How Google Works, nous soutenons qu’il existe une nouvelle génération d’employés, les créatifs intelligents, qui sont essentiels pour obtenir cette vitesse et cette innovation. Le créateur intelligent est une personne qui combine la profondeur technique avec le sens des affaires et la créativité. […] En faisant des recherches pour ce livre et en discutant avec les dizaines de personnes que Bill avait coachées au cours de sa carrière, nous nous sommes rendu compte que cette thèse passait à côté d’un élément important du puzzle de la réussite des entreprises. Il existe un autre facteur tout aussi essentiel à la réussite dans les entreprises: des équipes qui agissent comme des communautés. Intégrer les intérêts et mettre de côté les différences pour être obsédé individuellement et collectivement par ce qui est bon pour l’entreprise. […] Mais adhérer à ces principes est difficile, et cela devient encore plus difficile quand il faut tenir compte de facteurs tels que des industries en transition rapide, des modèles économiques complexes, des changements technologiques, des concurrents intelligents, des attentes exorbitantes des clients, une expansion mondiale, des coéquipiers exigeants… […] Pour apaiser les tensions et transformer une équipe en une communauté, vous avez besoin d’un coach, quelqu’un qui travaille non seulement avec les individus, mais aussi avec les équipes. » [Pages 22-4]
« Bill a commencé sa carrière en tant que spécialiste de la publicité et du marketing, puis a ajouté les ventes à son portefeuille après avoir rejoint Apple. Mais, grâce à ses expériences dans le monde de la technologie, chez Apple, Intuit, Google, etc, Bill en est venu à apprécier la prééminence de la technologie et du produit dans l’ordre hiérarchique des affaires. « Le but d’une entreprise est de partir de votre vision du produit et de la concrétiser », a-t-il déclaré à une conférence. « Vous définissez ensuite tous les autres composants autour du produit – la finance, les ventes, le marketing – pour faire en sorte que le produit soit commercialisé et s’assurer du succès. » Ce n’était pas comme cela que les choses se passaient dans la Silicon Valley, ou dans la plupart des autres endroits, lorsque Bill est arrivé en ville dans les années 1980. Le modèée alors était que mêm si une entreprise pouvait être lancée par un technologue, les pouvoirs en place feraient bientôt appel à un homme d’affaires ayant de l’expérience dans les domaines de la vente, du marketing, de la finance ou des opérations, pour diriger l’entreprise. Les gestionnaires ne pensaient pas aux besoins de l’ingénieur et ne se concentraient pas sur le produit d’abord. Bill était un homme d’affaires, mais il croyait que rien n’était plus important qu’un ingénieur à qui on donnait du pouvoir. Son argument récurrent: les équipes produits sont le cœur de l’entreprise. Ce sont elles qui créent les nouvelles fonctionnalités et les nouveaux produits. » [Pages 67-8]
À nouveau, à propos des équipes et de la confiance: « Il n’est pas surprenant que lorsque Google a mené une étude pour déterminer les facteurs qui influent sur les équipes les plus performantes, la sécurité psychologique est arrivée en tête de liste [1]. Les notions communes selon lesquelles les meilleures équipes sont composées de personnes possédant des compétences complémentaires ou de personnalités similaires ont été réfutées; les meilleures équipes sont celles qui ont le plus de sécurité psychologique, et cela commence par la confiance. » [Page 84]
À propos du talent: « Bill recherchait quatre caractéristiques chez les personnes. La personne doit être intelligente, pas nécessairement du point de vue académique, mais davantage du point de vue de sa capacité à se mettre rapidement au diapason dans différents domaines, puis à établir des liens. Bill appelait cela la capacité à faire des « analogies lointaines ». La personne doit travailler dur et doit avoir une grande intégrité. Enfin, la personne devait avoir la caractéristique difficile à définir: le cran. La possibilité de se faire assommer et d’avoir la passion et la persévérance nécessaires pour se relever et recommencer. » [Page 116]
Enfin, et peut-être plus important encore, à propos des fondateurs: « Il y avait une place très importante dans son cœur pour les personnes qui ont le courage et les compétences nécessaires pour créer une entreprise. Ils sont suffisamment sains d’esprit pour savoir que chaque jour est une bataille pour leur survie contre tous les obstacles et assez fous pour penser qu’ils peuvent réussir de toute façon. Et les garder de manière significative est essentiel au succès de toute entreprise. Trop souvent, nous pensons que la gestion d’une entreprise est un travail d’opérations et, comme nous l’avons déjà vu, Bill considérait l’excellence opérationnelle comme très importante. Mais lorsque nous réduisons le leadership de la société à son essence opérationnelle, nous nions un autre élément très important: la vision. Plusieurs fois, les responsables opérationnels arrivent et, même s’ils dirigent mieux l’entreprise, ils en perdent le cœur et l’âme. » [Page 178]
En conclusion, les gens, les gens, les gens…
[1] On trouvera plus de détails sur cette étude dans James Graham, «Ce que Google a appris de sa quête pour bâtir l’équipe parfaite», « What Google Learned from Its Quest to Build the Perfect Team » New York Times, 25 février 2016.