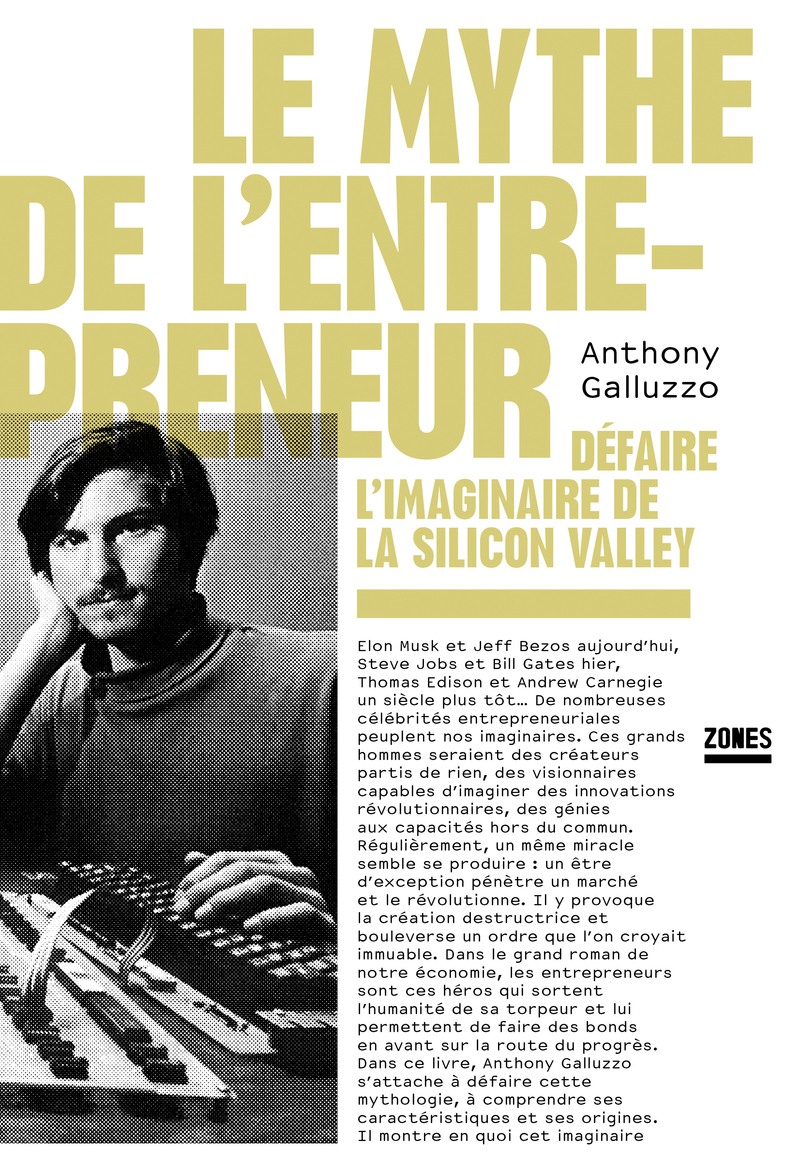J’ai terminé ma lecture de l’ouvrage de Anthony Galluzzo dont j’ai déjà parlé dans la partie 1 il y a quelques jours. J’hésite entre l’irritation et une appréciation plus positive car je ne sais pas si l’auteur veut simplement défaire l’imaginaire de la région ou en critiquer plus largement le fonctionnement. En effet dans les deux dernières pages de son excellent ouvrage il écrit : « Achevant la lecture de ce livre, certains s’interrogeront peut-être sur la possibilité de « défaire » l’imaginaire entrepreneurial ; non pas seulement de le déconstruire, mais de le mener à la défaite. » Puis il ajoute : « De nombreux commentateurs l’ont déjà constaté : pour défaire un système économique et social il ne suffit pas de démystifier les croyances et de réfuter les syllogismes que véhicule son idéologie. Il faut aussi penser simultanément une autre économie et un autre imaginaire, faire prospérer d’autres représentations et incarnations désirables de l’existence humaine. »
La Silicon Valley comme écosystème et ses côtés sombres
Je ne sais que penser. Un imaginaire ne fait pas système, même s’il en est sans doute un ingrédient important. Derrière le story telling et le mythe de l’entrepreneur héroïque, il y a un écosystème dont Galluzzo parle plus dans l’entretien qu’il a donné à l’Echo (Pour comprendre l’économie, il faut la raconter par les écosystèmes, non par les individus) que dans son livre. La Silicon Valley est un écosystème et pas (seulement) une fabrique de mythes pour cacher une situation plus sombre [1].
Il y a bien sûr du sombre dans la Silicon Valley. Il le montre bien dans le début de son ouvrage et que je relate dans mon précédent post, par exemple à travers la guerre pour les talents ou l’invisibilisation de l’État. Son portait est de plus en plus à charge dans la suite, même si les nouveaux éléments sont tout aussi véridiques:
– un déséquilibre flagrant de la population d’entrepreneurs avec peu de femmes ou d’Afro-américains,
– une sous-représentation des syndicats qui aurait mérité une analyse plus approfondie,
– des employés en bas de l’échelle moins bien traités (en admettant que ces emplois n’aient pas été délocalisés),
– une fiscalité aussi déséquilibrée [page 206] qui aurait mérité là aussi une analyse plus approfondie.
Galluzzo mentionne le tokénisme comme raison du story telling. Dans la littérature sociologique, on appelle « tokénisme » la pratique consistant à intégrer symboliquement des groupes minoritaires pour échapper à l’accusation de discrimination [Page 204]. Galluzzo admet aussi qu’il n’y a pas toujours de story telling. Larry Page et Sergey Brin, les créateurs de Google sont à l’origine de l’une des principales puissances de la Silicon Valley et sont pourtant assez méconnus du grand public. Ils se sont toujours montrés assez discrets, avec des prises de parole rares et bien circonscrites. Ils n’ont pas investi dans le storytelling et le personal branding [Page 218]. Galluzzo ne mentionne pas non plus les milliers d’entrepreneurs inconnus et qui ont souvent échoué, qui sont une composante essentielle de la région.
Il ajoute que la Silicon Valley se serait épanouie avec le néolibéralisme thatchérien tout puissant. Mais il me semble qu’il oublie que la Silicon Valley s’est réellement épanouie dans les deux décennies qui précédent, celle des années 60 (Fairchild, Intel) qui a permis le développement des semi-conducteurs et celle des années 70 pour les ordinateurs. Il semble oublier même s’il le mentionne que sans la structuration du capital-risque dans ces deux décennies, mais aussi sans l’arrivée de migrants hautement qualifiés dans les décennies qui suivirent, il n’y aurait sans doute pas de Silicon Valley telle qu’elle existe (et non pas telle qu’elle est mythifiée). Je ne crois pas que le sujet soit à ce point mis sous le tapis. Dès les années 80, un auteur relativement grand public montrait les aspects plus sombres de la région dans son livre Silicon Valley Fever. On pourra aussi lire Les péchés capitaux de la Silicon Valley
Qu’est-ce qu’un entrepreneur ?
Son passage [pages 196-98] sur la définition ou les traits d’un entrepreneur est aussi très intéressant.
Comment définir l' »entrepreneur » ? Une première approche consiste à le considérer simplement comme un créateur d’entreprise : celui qui démarre et organise une activité économique. On amalgame le petit artisan et le grand patron ; le boulanger et le start-uper richissime. Pour nous consacrer plutôt à ces derniers, faudra-t-il adjoindre à notre définition un ordre de grandeur quant à la réussite économique de l’entreprise et si oui, lequel ? Doit-on limiter la catégorie à ceux qui ont fondé une petite entreprise en hyper-croissance? Une autre solution consiste à faire intervenir la notion de risque. L’entrepreneur serait celui qui mobilise des ressources dans une situation d’incertitude; il serait celui qui réussit ses paris sur l’avenir. [Page 196]
Face à ces problèmes, il peut sembler indispensable de faire appel au critère de l’innovation. L’entrepreneur serait celui qui organise une nouvelle combinaison de moyens de production : celui qui élabore un nouveau produit, développe une nouvelle méthode de production, crée un nouveau marché, conquiert une nouvelle source d’approvisionnement ou bouleverse l’organisation d’un secteur tout entier. […] Or définir l’entrepreneur comme innovateur nécessite de facto de séparer l’innovation du processus, de l’extraire du continuum, de l’attribuer, souvent très artificiellement, à un acteur unique. [page 197]
Lorsque la recherche en entrepreneuriat s’est développée dans les années 80, elle s’est rapidement concentrée sur la questions de savoir qu’elle était la personnalité particulière de l’entrepreneur. […] Parmi les traits qui ont fait l’objet de plusieurs recherches, on relève la propension au risque, la tolérance à l’ambiguïté, le besoin d’accomplissement et le locus de contrôle interne [le locus de contrôle interne désigne la tendance que les individus ont à considérer que les évènements qui les affectent sont le résultat de leurs actions] Ces recherches n’ont donné aucun résultat probant. [Page 198]
Galluzzo aurait pu mentionner la définition d’une startup donnée par Steve Blank et presqu’universellement adoptée, elle donne un périmètre assez convaincant à l’entrepreneur tech, celui dont il est question ici : « Les start-up sont des entités temporaires destinées à la recherche d’un modèle d’affaires extensible et reproductible. »
Enfin à plusieurs reprises, Galluzzo semble montrer sa préférence pour le bâtisseur plus que pour le créateur, Markkula plutôt que Jobs aux premiers jours d’Apple, Cook plutôt que Jobs dans ses derniers jours: Bloomberg a récemment classé tous les PDG de l’histoire d’Apple en fonction de la façon dont a évolué la valorisation de l’entreprise sous leur direction; Steve Jobs (1997-2011, +12,4%) se situe loin derrière Mike Markkula (1981-1983, +64%) et John Sculley (1993-1993, +106%). Tim Cook les surclasse tous avec une augmentation de +561%. Je n’ai pas eu accès à l’article et j’ai pu me tromper mais j’arrive à des résultats différents pour les taux de croissance issus de mes multiples : Markkula, 4x en 2ans soit 100%, Sculley environ 1x soit 0%, Jobs (seconde période) 100x en 14 ans soit 40% et Cook, 10x en 12 ans soit 25%. Enfin Jobs (1ère période – en réalité Scott) 1600x en 4 ans soit 500%. Mais ce dernier sujet est d’autant moins important que je ne suis pas sûr de tous ces chiffres. Fondateur, bâtisseur, storytelling et réalité, voilà des sujets qui restent passionants. Merci à Anthony Gazzullo pour son excellent livre et les réflexions qu’il m’a suscitées.
[1] Voici des éléments qui décrivent un écosystème et que j’ai repris d’un post d’octobre 2015 :
« les 5 ingrédients nécessaires aux clusters high-tech: »
1. des universités et les centres de de la recherche de très haut biveau;
2. une industrie du capital-risque (institutions financières et investisseurs privés);
3. des professionnels expérimentés de la haute technologie;
4. des fournisseurs de services tels que avocats, chasseurs de têtes, spécialistes des relations publiques et du marketing, auditeurs, etc.
5. Enfin et surtout, un composant critique mais immatériel: un esprit de pionnier qui encourage une culture entrepreneuriale.
“Understanding Silicon Valley, the Anatomy of an Entrepreneurial Region”, par M. Kenney, plus précisément dans le chapitre: “A Flexible Recycling” par S. Evans et H. Bahrami
Paul Graham dans How to be Silicon Valley?? « Peu de start-up se créent à Miami, par exemple, parce que même s’il y a beaucoup de gens riches, il a peu de nerds. Ce n’est pas un endroit pour les nerds. Alors que Pittsburgh a le problème inverse: beaucoup de nerds, mais peu de gens riches. » Il ajoute également à propos des échecs des écosystèmes: « Je lis parfois des tentatives pour mettre en place des « parcs technologiques » dans d’autres endroits, comme si l’ingrédient actif de la Silicon Valley étaient l’espace de bureau. Un article sur Sophia Antipolis se vantait que des entreprises comme Cisco, Compaq, IBM, NCR, et Nortel s’y étaient établi. Est-ce que les Français n’ont pas réalisé que ce ne sont pas des start-up? »
Enfin, les écosystèmes entrepreneuriaux ont besoin de 3 ingrédients – je cite:
– Du capital: par définition, aucune nouvelle entreprise ne peut être lancée sans argent et infrastructures pertinentes (du capital engagé dans des actifs tangibles);
– Du savoir-faire: vous avez besoin d’ingénieurs, de développeurs, de designers, de vendeurs: tous ceux dont les compétences sont nécessaires pour le lancement et la croissance des entreprises innovantes;
– De la rébellion: un entrepreneur conteste toujours le statu quo. Sinon, ils innoveraient au sein de grandes entreprises établies, où ils seraient mieux payés et auraient accès à plus de ressources.