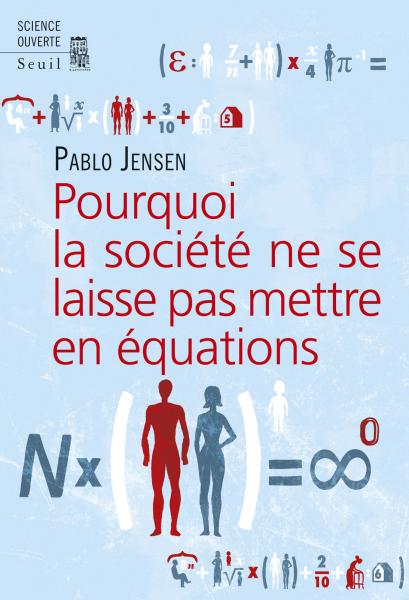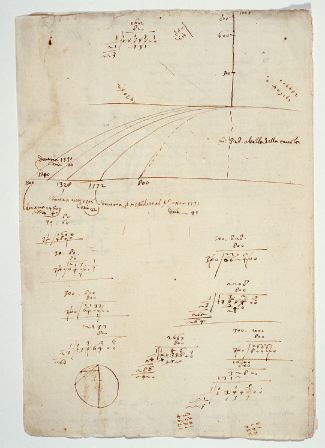J’écris de temps en temps et peut-être même de plus en plus souvent sur cette autre facette de l’innovation et de l’entrepreneuriat (qui reste ma passion, positivement) une facette qui est plus sombre, plus négative, une vision plus critique de l’impact de l’innovation sur la société. Je lis en ce moment Technocritiques – Du refus des machines à la contestation des technosciences de François Jarrige. C’est un livre riche, âpre, exigeant, mais exceptionnel pour tous ceux que le sujet intéresse.
Sous des apparences extrêmement critiques, le livre montre que les aspects positifs et négatifs du progrès se sont toujours développés en parallèle. Ma lecture la plus proche de ce travail fut sans doute celle de Bernard Stiegler, Dans la disruption – Comment ne pas devenir fou ? sans oublier les travaux de Libero Zuppiroli, telles que Les utopies du XXIe siècle. Merci à lui pour m’avoir mentionner ce livre remarquable.
Voici une copie intégrale d’un long passage passionnant aux pages 87-88. Il pourrait décrire notre monde, il en décrit un plus ancien.
« Si nous devions caractériser notre temps par une seule épithète, nous ne le nommerions pas âge héroïque, religieux, philosophique ou moral ; mais l’âge mécanique, car c’est là ce qui le distingue entre tous les autres. » [1] Carlyle incarne la dénonciation romantique du « mammonisme » (c’est-à-dire le culte religieux du dieu Argent), dont le déferlement mécanique de son temps est l’une des manifestations. Pourquoi toujours s’efforcer, grâce aux mécaniques, de vendre « à plus bas prix que toutes les autres nations et cela jusqu’à la fin du monde », pourquoi ne pas « vendre à prix égal », demande-t-il ? [2] Il invite les « hommes ingénieux » à trouver le moyen de distribuer plus équitablement les produits plutôt qu’à chercher toujours les moyens de les réaliser au plus bas coût : « un monde composé de simples machines à digérer brevetées n’aura bientôt rien à manger : un tel monde s’éteindra et de par la loi de la nature il faut qu’il s’éteigne. »
A la même époque, Michelet, le grand historien romantique français, découvre le gigantisme du machinisme lors d’un voyage en Angleterre en 1834. Il met également en scène l’ambivalence des effets des machines. Impressionné par les « êtres d’acier » qui asservissent « l’être de sang et de chair », il est persuadé néanmoins que l’on continuera de préférer aux « fabrications uniformes des machines les produits variés qui portent l’empreinte de la personnalité humaine ». Si la machine est indéniablement un « puissant agent du progrès démocratique » en « mettant à la portée des plus pauvres une foule d’objets d’utilité », elle a aussi son revers terrible : elle crée un « misérable petit peuple d’hommes-machines qui vivent à moitié [et] qui n’engendrent que pour la mort ». [3]
L’inquiétude à l’égard des machines s’atténue à l’époque victorienne, avec l’expansion de la prospérité de la période impériale, le déclin des violences ouvrières, la montée en puissance de l’économie politique. Elle continue toutefois de susciter les craintes de certains moralistes, comme John Stuart Mill, penseur radical complexe, libéral fasciné par la socialisme et féministe justifiant l’impérialisme. Dans ses Principles of Political Economy (1848), Mill propose un état des lieux de l’économie politique de son temps. Il prend ses distances à l’égard des économistes qui donnent une image trop optimiste du changement technique, il exprime des réticences à l’égard des effets bénéfiques de la division du travail et considère que l’État doit compenser les effets néfastes du machinisme. Mais sa critique dépasse ces questions classiques car John Stuart Mill propose une théorie de « l’état stationnaire » qui rompt avec l’économie classique. Il décrit cet « état stationnaire des capitaux et de la richesse » comme « préférable à notre situation actuelle », marquée par la lutte de tous contre tous. Il l’envisage comme un monde façonné par la « prudence » et la « frugalité », où la société serait composée « d’un corps nombreux et bien payé de travailleurs » et de « peu de fortunes énormes » ; ce monde « stationnaire », où chacun aurait suffisamment pour vivre, laisserait une place à la solitude et à la contemplation « des beautés et de la grandeur de la nature ». Dans ce monde, les « arts industriels » ne s’arrêteraient évidemment pas, mais « au lieu de n’avoir d’autre but que l’acquisition de la richesse, les perfectionnements atteindraient leur but, qui est la diminution du travail. » [4]
A suivre, peut-être….
Sources:
[1] Thomas Carlyle, “Signs of the Times”, Edinburgh Review vol. 49, 1829, p. 439-459
Were we required to characterise this age of ours by any single epithet, we should be tempted to call it, not an Heroical, Devotional, Philosophical, or Moral Age, but, above all others, the Mechanical Age. It is the Age of Machinery, in every outward and inward sense of that word; the age which, with its whole undivided might, forwards, teaches and practises the great art of adapting means to ends.
http://www.victorianweb.org/authors/carlyle/signs1.html
[2] Thomas Carlyle, “Past and Present” (1843), trad fr Cathédrales d’autrefois et usines d’aujourd’hui. Passé et présent, trad. fr. de Camille Bos, Editions de la Revue Blanche, Paris, 1920, p.289
I admire a Nation which fancies it will die if it do not undersell all other Nations, to the end of the world. Brothers, we will cease to undersell them; we will be content to equal-sell them; to be happy selling equally with them! I do not see the use of underselling them.
A world of mere Patent-Digesters will soon have nothing to digest: such world ends, and by Law of Nature must end, in ‘over-population;’
P. 229-31, http://www.gutenberg.org/files/26159/26159-h/26159-h.htm
[3] Jules Michelet, « Le peuple ». Flammarion. Paris, 1974 [1846]
[4] John Stuart Mill, « Principes d’économie politique », trad. fr. de Léon Roquet, Paris 1894 [1848] Pages 138-142.